Isaac Asimov et les robots
|
Né en Russie, naturalisé américain, il fut diplômé de biologie et de chimie. Après s’être longtemps partagé entre le roman et la vulgarisation scientifique, il revint à la fiction. Contrairement au courant principal (et commercial) qui consistait en pirates et autres aventuriers de l’espace et dont les scenarii étaient simplement glissés dans un décor futuriste et parfois aberrant, ce grand maître de l’anticipation construisait le futur avec toute la rigueur d’un esprit scientifique, et, si certaines de ses histoires furent contredites par après, on doit lui reconnaître d’incontournables qualités de visionnaire. |

|
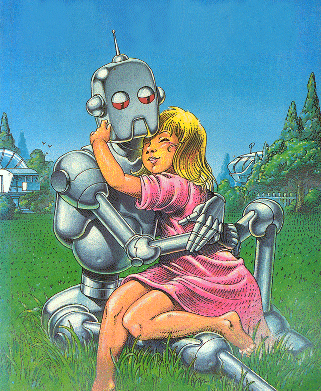
|
Asimov a inventé, en 1942, le terme de robot (qui vient de travailleur en Roumain) dans son sens actuel (une mécanique pilotée par un cerveau électronique et capable d’effectuer certaines tâches sans intervention humaine) ainsi que le nom de la science qui s’en occupe, la robotique. A cette époque, le plus gros inconvénient qui faisait du robot intelligent une chimère était que la taille des ordinateurs était monstrueuse en comparaison de ceux de la fin du 20ème siècle, et, pour piloter un androïde (robot à morphologie humaine), le cerveau nécessaire aurait probablement eu la taille d’une maison ! |
|
Asimov est l’inventeur du terme robot qui s’applique au robot moderne
(utile et sans danger) au contraire des robots précédents qui
se retournaient systématiquement contre leur créateur. |
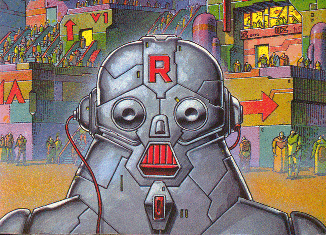
|
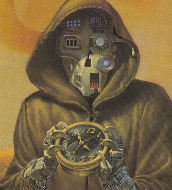
|
Les prédictions d'Asimov réalisées à ce jour :
|
|
Tous les robots (sauf les derniers) d’Isaac Asimov obéissent
à ce qu’il a défini lui-même comme étant
les Trois Lois de la robotique, lois sensées régir tous les robots
de telle manière qu’ils obéissent aux ordres des êtres
humains et ne soient pas un danger pour leurs utilisateurs. |
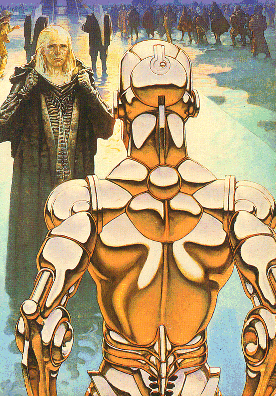
|
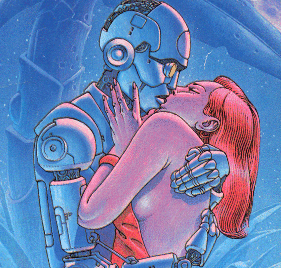
|
Première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni,
restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. |
|
Asimov a décrit trois types de robots liés à des environnements spatio-tempo-socio-politiques particuliers mais on y remarque que le climat social est le facteur le plus significatif. |
|
Le premier environnement est celui que nous connaissons: la terre de la fin
du 20ème siècle, et les robots y ont des carcasses volontairement
métalliques et inesthétiques, la terre est surpeuplée
et les robots (qui volent le travail des humains) sont souvent maltraités
et parfois détruits. |
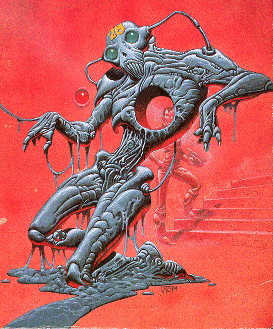
|
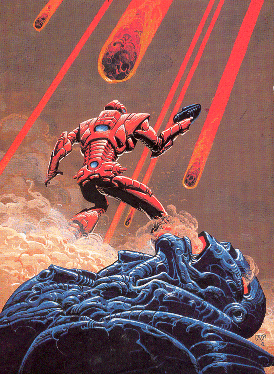
|
Le deuxième environnement simule une époque placée à
plus de mille ans dans le futur; la Terre a colonisé de nombreuses planètes
qui, avec le temps, se sont différentiées et séparées
de la Terre et finissent même par considérer les Terriens comme
des inférieurs et à nier leur origine terrestre. |
|
Le premier robot humaniforme s’appelle R. Daneel Olivaw. Il est aussi le seul en activité, le second ayant été terminé par gel mental (ou robloc). |
|
Le troisième environnement ne traite pratiquement plus de la terre
et décrit un nouveau genre de robot construit à partir de millions
de micro-robots (ou nanites) comme le corps humain est construit de millions
de cellules.
|
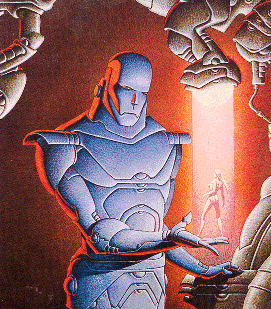
|
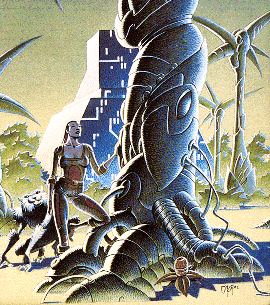
|
Dans le cas des robots, cette délocalisation
de l’intelligence décharge le cerveau des tâches réflexes
(coordination des mouvements) et lui donne une efficacité accrue, équivalente
au modèle humain avec, en plus, la possibilité de s’adapter
jusque dans sa structure selon les besoins. |
|
Véritables mini-usines électrochimiques autonomes, les micro-robots fournissent leur propre énergie, communiquent entre eux et avec le cerveau central, peuvent se déplacer les uns par rapports aux autres et se coordonner et, finalement, peuvent produire certains composés chimiques par électrolyse de l’air ou de tout autre milieu ambiant. |
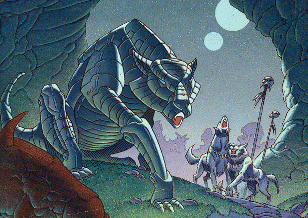
|
***